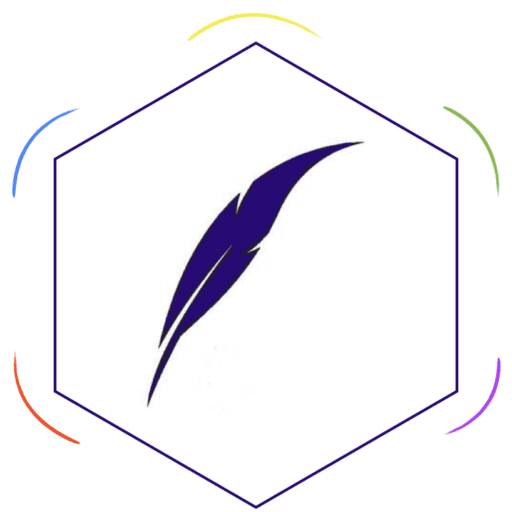Depuis la crise diplomatique qui a éclaté entre Kigali et Paris et après avoir pointé du doigt la complicité de ce dernier dans le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis, la langue française, subit un coup dur : en 2008, elle est remplacée par l’anglais en tant que langue d’enseignement. C’est le déclin et l’affaiblissement du français qui a formé l’élite du Rwanda. Elle devient alors (presque) absente dans le pays au point de se demander ce que deviendront ses locuteurs depuis la période coloniale. Des générations qui maitrisent alors cette langue ne savent pas sur quel pied danser, alors que la langue anglaise, nouvellement adoptée, n’était pas beaucoup parlée dans un pays colonisé par les locuteurs francophones. Aujourd’hui, les efforts déployés pour la raviver sont nombreux.

La renaissance d’une francophonie coopérative et multiforme
En 2009, les autorités rwandaises ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques avec la France dans le cadre d’un premier rapprochement entre 2008 et 2011. Celui-ci s’est matérialisé par un déplacement du Président Sarkozy à Kigali en 2010 et une visite retour du président rwandais en 2011, mais resté sans suite entre 2012 et 2018.
Le dynamisme de la relation bilatérale s’est aussi traduit par un retour de l’AFD (Agence française de développement) au Rwanda sur différents projets en prêts souverain et subventions. Cette dynamique, initiée en 2019 a été suivi de la signature, durant la visite du Président de la République, d’une feuille de route de 500 millions d’euros entre 2019 et 2023 pour soutenir la stratégie de développement du Rwanda.[1]
Après le réchauffement des relations diplomatiques avec la France, le Rwanda relance alors l’intérêt pour le français pour plusieurs raisons. D’abord pour un réel besoin de développer l’employabilité des jeunes mais aussi d’appartenir à des organisations internationales. Ensuite, c’est pour des ambitions économiques : l’Afrique francophone étant un marché de taille que le Rwanda gagnerait à conquérir pour améliorer ses performances en la matière. Enfin, c’est l’attention portée par Kigali à ces pays pour les séduire afin de « s’ériger en nouveau leader du panafricanisme ».[2]
Cet intérêt du Rwanda pour la langue française, se concrétise également avec de nouveaux programmes d’apprentissage et une nouvelle stratégie gouvernementale. Ces ambitions rwandaises marquent alors un tournant majeur dans le but de raviver le goût et l’intérêt d’une langue plus ou moins abandonnée. Ainsi, Emmanuel Macron inaugure le Centre Culturel Francophone du Rwanda en 2021, sept ans après la fermeture de l’Institut français et la nomination de l’ambassadeur de France au Rwanda est validée par le conseil des ministres quelques semaines plus tard, six ans après le départ de son prédécesseur.
Dans ce même sillage, des initiatives et leviers significatifs en faveur de la francophonie sont déverrouillés pour faire renaître l’intérêt de la langue française au Rwanda. Revenons sur quelques-unes des initiatives qui, sans doute, semblent apporter de l’espoir à la langue française et au peuple rwandais condamné à oublier une langue dans laquelle il été éduqué.
En 2021, l’Administrateur de l’OIF s’est rendu au Rwanda, pays de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, dans le cadre d’une visite de travail et dans l’objectif de renforcer la coopération entre l’OIF et ce pays membre, notamment dans trois domaines prioritaires d’intervention de l’OIF : la langue française et la culture, l’égalité femmes-hommes, et l’économie et le numérique. Dès lors, des actions concrètes ont été mises en place.
Premièrement, en 2022. Cette même année, une bourse aux livres est organisée et six écoles en bénéficient la première année, huit autres la deuxième année, quinze écoles et une bibliothèque à Gisenyi, La bibliothèque le Phare, la troisième année.
Puis, entre 2022 et 2024, un projet intitulé « Pour un ancrage francophone d’excellence » a été mené. Le projet mis en œuvre par l’Ambassade de France au Rwanda en partenariat notamment avec l’Université catholique de l’Ouest et des structures locales d’enseignement supérieur, a permis à seize enseignants rwandais d’obtenir un Diplôme Universitaire (D.U) Outils et Pratiques Pédagogiques du FLE. De plus, l’association « Rassemblement des Enseignants de Français du Rwanda » a délivré des formations à des enseignants de français, visant à développer la compréhension des niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), et la pédagogie de l’enseignement du français en tant que langue étrangère. Les initiatives susmentionnées sont loin d’être les seules à militer en faveur de cet héritage universel linguistique. Notons aussi la création de neuf malles pédagogiques contenant du matériel d’enseignement, des manuels et des jeux à utiliser en classe de FLE qui circulent dans les écoles rwandaises et pouvant être empruntées pendant un trimestre avant qu’elles soient attribuées à de nouvelles écoles.
Deuxièmement, en 2024 en marge du Sommet de la Francophonie de Villers-Cotterêts, un concours scolaire « Refaire le monde » a été organisé par l’Ambassade de France au Rwanda, le Centre Culturel Francophone du Rwanda et l’Organisation Internationale de la Francophonie. Six cent quarante élèves, vingt-cinq écoles, quarante professeurs et onze villes ont été impliqués. De surcroît, des ateliers pédagogiques à destination des professeurs pour échanger des bonnes pratiques sont organisés à l’Institut Français de Kigali de manière périodique et par trimestre, soit en ligne, soit en physique. Parallèlement, il y a un accompagnement des associations éducatives francophones locales dans le but de les soutenir dans leurs initiatives à travers des réseaux de partage et de promotion des nouveautés en formations, concours, etc. Bien que la plupart de ces initiatives de promotion de la francophonie concernent les écoles publiques, les écoles privées bénéficient aussi des activités proposées. Dans le cadre d’un programme mis en œuvre par France Education International et suivi par l’Ambassade de France au Rwanda, deux assistantes de langue française sont placées au sein d’écoles privées francophones en 2024, dont une à Nyamata et l’autre à Gisenyi pour dispenser des cours de français dans leurs écoles respectives. A ces assistantes s’ajoutent trois volontaires de la solidarité internationale (VSI) Francophonie placés au sein de plusieurs institutions : l’Université du Rwanda (Campus de Gikondo et Campus de Huye) et le SNEC (Secrétariat national de l’enseignement catholique). Notons que les missions de chacun de ces volontaires varient en fonction des besoins de leur établissement d’accueil. Les organismes d’envoi sont France Volontaires et la Délégation Catholique pour la Coopération.
Il faut également noter qu’en 2024, un test de niveau de langue a été réalisé par l’Agence Française de Développement sur 2000 enseignants dans le but d’identifier les niveaux de maîtrise du français, afin d’organiser une formation linguistique / pédagogique qui leur sera destinée. Certains des cent cinquante enseignants ont bénéficié alors d’une formation de la part de formateurs de TV5 Monde, dans le but de développer leurs compétences de formateurs et qu’ils puissent justement former leurs collègues sur le terrain à partir de 2025. Cela s’inscrit dans le cadre du Plan de l’enseignement/apprentissage du français orchestré par le MINEDUC et l’AFD.
Troisièmement, en 2024, 110 professeurs se sont retrouvés à Kigali pour la Journée Internationale des Professeurs de français (JIPF) autour d’une conférence et d’une table ronde sur « l’enseignement du français aujourd’hui ». Cet événement a pu avoir lieu grâce à une collaboration étroite entre l’Ambassade de France, l’AFD et le Rwanda Basic Education Board.
La redynamisation du français est également une priorité de l’OIF qui place des enseignants-volontaires au sein des écoles publiques rwandaises. Ils sont chargés d’enseignement mais également de projets et de la formation des enseignants. Ils sont au nombre de 41 en 2024. Ce projet de Mobilité des enseignants de et en français est le résultat d’une rencontre de l’Administrateur de l’OIF et du ministre d’Etat à l’Enseignement primaire et secondaire du Rwanda en 2021. Dès 2022, cette initiative a vu la participation de près de 100 enseignants volontaires, contribuant à renforcer l’enseignement de la langue française dans ce pays aux côtés des autres langues officielles.
Dernièrement, a l’heure où le développement du numérique avance rapidement, l’organe de la Francophonie, l’OIF, ne ménage aucun effort et s’active également sur les perspectives d’une collaboration avec le Rwanda dans la mise en place du projet de formation aux métiers du numérique de l’OIF (D-Clic) et dans la formation des jeunes et des femmes aux sciences, au numérique et à l’innovation.[3]

Une francophonie rayonnante et prête à relever des défis de la population
D’une manière générale, le rayonnement de la francophonie n’appartient pas seulement à la France. Il se joue aussi au sein de tous les pays locuteurs francophones, de l’Afrique de l’Est à l’Afrique de l’Ouest, en passant également par les pays du Maghreb, le Canada, la Suisse, etc. Il dépend et dépendra de la poursuite du processus de scolarisation, de l’enseignement du français dans cette région plus anglophone que francophone. La promotion de la francophonie dans des activités de développement de la population locutrice est aussi un facteur important pour rassurer les francophones et rappeler que le français n’est pas dépassé. Dans cette logique il est évident que la francophonie au Rwanda prend une nouvelle posture et tente de rattraper son recul : l’esprit de la francophonie continue à privilégier la diversité culturelle pour manifester une autre manière d’être au monde. Sans risque de se tromper, le français intervient dans plusieurs secteurs vitaux de développement du Rwanda : l’éducation, l’économie, le tourisme, pour ne citer que cela.
Toutefois, il est important de signaler que les enjeux au sein de la francophonie dont la recherche et le développement la coopération économique seront essentiels pour l’avenir de l’humanité. Dès lors, le rayonnement du français peut être mis au service de l’intégration culturelle et économique. Il s’agit de vivre ensemble, d’être libres ensemble, d’être ouvert et solidaire. Il s’agit d’œuvrer pour la diversité linguistique et culturelle, l’économie et l’entrepreneuriat, la formation, le développement durable. Cela lui assure un avenir prometteur et prouve qu’elle est un partenaire fiable et crédible dans le développement multisectoriel et multilatéral rwandais car le français souffle sur les cinq continents. Cette langue bouge, voyage et se réinvente dans la diversité et la liberté du nord au sud en passant par l’est et l’ouest comme le disait Victor Hugo : « Les langues ni le soleil ne s’arrêtent plus. Le jour où elles se fixent, c’est qu’elles meurent ».

Aux pays francophones, l’avenir est pour nous et c’est nous
Pourquoi le Rwanda s’intéresse-t-il de nouveau à la langue de Molière ? A-t-il compris qu’il ne devrait pas oublier cette langue et qu’elle devait rester au service du peuple ?
Sans prétendre répondre à toutes ces questions, nous pouvons dégager quelques hypothèses.
Evidemment, l’anglais est très important dans cette partie de l’Afrique mais il faut être conscient et admettre qu’il se tient aux côtés du français, lui aussi fort, actuellement et pour des années à venir.
« La francophonie est l’espace linguistique qui connaît la plus forte croissance : celle-ci serait de 143% entre 2015 et 2065 (62% pour l’anglais), selon l’ONU, d’ici à 2065, un milliard de personnes devrait parler français. Le français se placerait alors au deuxième rang des langues internationales derrière l’anglais ».[4]
De ce constat, il est important que ceux qui parlent le français et qui l’utilisent officiellement tiennent compte de cette étude pour s’assumer francophones car, dans son âme, la francophonie se veut avant tout multiculturelle et ne contrait aucune culture à adhérer à son idéologie. Elle prône la complémentarité, c’est une langue de paix et de pardon, un pont qui a réunifié la France et le Rwanda. Pour cela, le choix du Rwanda de revenir sur cette langue et à la revaloriser pour une vision à long terme est logique. En somme, il est clair que la francophonie au Rwanda est en marche vers l’excellence avec plusieurs acteurs qui conjuguent leurs efforts mais il faut toujours continuer pour que le français soit d’usage courant.
Par Thérence HATEGEKIMANA
[1] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/rwanda/relations-bilaterales/#:~:text=des%20Affaires%20%C3%A9trang%C3%A8res-,Relations%20%C3%A9conomiques,M%20d’euros%20en%202019.
[2] https://www.aa.com.tr/fr/afrique/pourquoi-le-rwanda-veut-il-renouer-avec-lafrique-francophone/686805
[3] https://www.francophonie.org/ladministrateur-de-loif-au-rwanda-2033#:~:text=D%C3%A8s%202022%2C%20cette%20initiative%20verra,s%20du%20et%20en%20fran%C3%A7ais