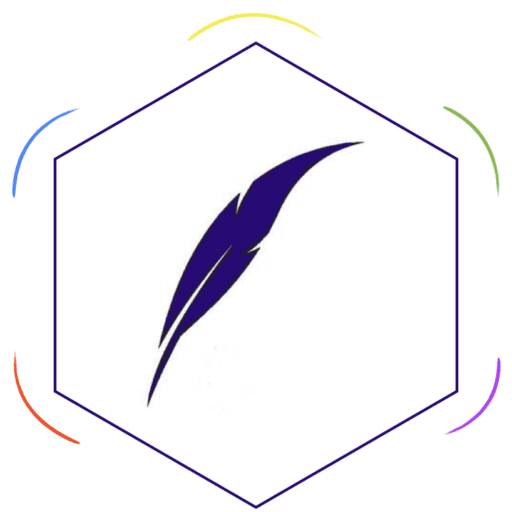Du récit épique à l’atrocité indicible, comment la langue forge notre perception des conflits.
Dans le fracas des bombardements et le chaos des images en continu, la guerre semble d’abord une affaire d’armes et de forces matérielles. Pourtant, avant même le premier coup de feu, une autre bataille, plus subtile mais tout aussi décisive, est engagée : celle des mots. Comment nommer l’horreur ? Comment qualifier l’ennemi ? Quel récit construire pour justifier, condamner ou simplement raconter ? Le français, avec sa longue histoire militaire, diplomatique et littéraire, offre un prisme unique pour saisir comment une langue structure la pensée du conflit. À l’ère de la guerre informationnelle et des réseaux sociaux, où les narratifs s’affrontent en temps réel, comprendre pourquoi et comment nous « disons la guerre » en français n’est pas un exercice académique. C’est une clé essentielle pour décrypter notre époque, résister à la manipulation et préserver la capacité à nommer le réel avec justesse. Cet article explore l’impérieuse actualité de cette bataille linguistique.

Le poids de l’histoire : une langue marquée par l’épopée et le droit
La langue française porte en elle les traces profondes de siècles de conflits. Elle a été forgée dans la chanson de geste et le récit épique (« fièrement, vaillamment »), puis disciplinée par la précision du vocabulaire militaire napoléonien et les codes de l’honneur. Cette double filiation crée une tension permanente entre la grandeur héroïque et la description technique et juridique.
Le XXe siècle, avec ses deux guerres mondiales et ses conflits de décolonisation, a brutalement fait évoluer ce lexique. Des écrivains-combattants comme Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars ou, plus tard, Pierre Schoendoerffer, ont cherché à traduire l’expérience viscérale du front, inventant parfois des images pour ce qui n’en avait pas[1]. Parallèlement, le développement du droit international humanitaire (les Conventions de Genève) a imposé un vocabulaire normatif précis « cible militaire », « civil », « crime de guerre », « proportionnalité » dont l’utilisation ou l’évasion est aujourd’hui au cœur des communications de guerre[2]. Dire la guerre en français, c’est naviguer entre ce registre épique hérité et l’exigence froide du droit, deux façons radicalement différentes de donner sens à la violence.
La bataille des narratifs : euphémismes, diabolisation et cadrage médiatique
La communication stratégique moderne est un théâtre d’opérations à part entière. Le choix des termes n’est jamais neutre ; il construit une réalité perçue. On observe plusieurs stratégies linguistiques récurrentes :
- L’euphémisme et la technicisation : parler d’« opération de police » plutôt que de guerre, d’« dommages collatéraux » pour désigner des victimes civiles, ou d’« frappes chirurgicales » évoquant précision et propreté, vise à estomper l’horreur et à moraliser l’action[3]. Ce processus, analysé par la philosophe Mona Chollet à propos d’autres sujets, désamorce l’émotion et anesthésie le jugement critique[4].
- La diabolisation et la déshumanisation : l’ennemi n’est plus un adversaire mais un « terroriste », un « fanatique », un « dictateur fou ». Cette catégorisation, en le plaçant hors de l’humanité commune, légitime une réponse sans limites. À l’inverse, se présenter en « force de libération » ou en « coalition pour la paix » ancre le narratif dans un idéal positif.
- Le cadrage médiatique : les chaînes d’information en continu doivent résumer des conflits complexes en phrases-chocs. Faut-il parler de « guerre civile » ou de « conflit intercommunautaire » ? «D’invasion ou d’opération spéciale ? Ce cadrage initial, souvent calqué sur le discours des belligérants, influence durablement la perception du public[5]. Le rôle du journaliste francophone est alors crucial pour questionner ces termes imposés et rechercher une justesse de langage qui résiste à la propagande.
L’indicible et le devoir de littérature : donner voix à l’expérience humaine
Face à la rhétorique officielle et à la brutalité des faits, une question se pose : certains aspects de la guerre sont-ils « indicibles » ? L’horreur absolue des tranchées, des camps ou des massacres de masse semble échapper au langage commun. C’est ici que la littérature et le témoignage entrent en jeu, non pour « expliquer », mais pour traduire une expérience.
Des auteurs comme Jonathan Littell (Les Bienveillantes), à travers une prose torrentielle et clinique, ou Olivier Rolin (Méroé), par la fragmentation et la réflexivité, tentent de construire des formes langagières à la hauteur de la complexité et de l’horreur[6]. Ils ne se contentent pas de rapporter des faits ; ils explorent les failles de la conscience, la banalité du mal, la mémoire traumatique. Leur travail est un contre-feu essentiel à l’appauvrissement du discours. Ils rappellent que dire la guerre, c’est aussi dire le silence, l’effroi, l’absurde, toutes ces réalités que le jargon militaire et politique tait.
Le front numérique : viralité, émoticônes et nouvelle grammaire du conflit
Aujourd’hui, la guerre se dit aussi et peut-être surtout sur Twitter (X), TikTok et Telegram. Ce nouvel écosystème modifie profondément la bataille des mots :
- Une viralité instantanée : un slogan (« Stop à la guerre »), un hashtag (#Soutien L’Ukraine), une accusation se propagent à la vitesse de la lumière, créant des communautés globales d’opinion. La vérification et la nuance deviennent des défis monumentaux.
- Une grammaire émotionnelle : la guerre se raconte en « histoires », en vidéos tremblantes, ponctuées d’émoticônes. Cette « émotionalisation » extrême du discours peut court-circuiter l’analyse rationnelle au profit d’une réaction viscérale, parfois manipulée.
- La désinformation comme arme : les « fake news », les « deep fakes » et les récits alternatifs exploitent la polysémie et la crédulité. Une même action peut être présentée comme une « libération » ou un « massacre » selon le canal consulté. Dans cette «guerre cognitive », la capacité à décoder le langage, à identifier les sophismes et les mots piégés devient une compétence civique fondamentale[7].
Pourquoi résister ? L’éthique du langage comme dernier rempart
Dans ce contexte, insister sur la précision du vocabulaire français peut sembler dérisoire. C’est pourtant un acte de résistance politique et éthique majeur, pour trois raisons :
- Nommer, d’exister : refuser les euphémismes, appeler un crime de guerre par son nom, c’est reconnaître la souffrance des victimes et leur redonner une dignité. C’est refuser l’effacement. Comme l’écrivait George Orwell, dont l’essai Politics and the English Language reste une référence absolue, « un mauvais usage du langage rend plus facile aux gens d’avoir de mauvaises pensées »[8].
- Préserver la pensée complexe : la langue appauvrie (« problème », « solution », « éradiquer », « cible ») produit une pensée appauvrie, manichéenne. Le français, avec sa capacité à la nuance, à l’abstraction et à la dialectique, doit être un outil pour penser la complexité des conflits, leurs racines historiques et leurs enjeux géopolitiques embrouillés.
- Garder le lien avec l’humain : face à la technicisation et à la déshumanisation numériques, la littérature, la poésie, le témoignage bien écrit, maintiennent un pont avec l’expérience humaine concrète. Ils nous rappellent que derrière les « pertes » et les « effectifs », il y a des vies individuelles, des histoires, un irréductible humain.
Dire la guerre en français aujourd’hui est un champ de bataille critique. Entre la propagande d’État, le récit émotionnel des réseaux sociaux et la froideur du jargon technique, l’espace pour un langage juste, nuancé et humain se rétrécit. Pourtant, plus que jamais, il importe de défendre la précision des mots, de cultiver la richesse du vocabulaire et d’écouter les écrivains qui, aux frontières du dicible, nous confrontent à la réalité de l’extrême violence.
C’est un combat pour l’intelligibilité du monde. Car une guerre que l’on ne sait plus nommer avec justesse est une guerre que l’on ne peut plus penser, donc que l’on ne peut plus arrêter, juger ou prévenir. En ces temps obscurs, la vigilance linguistique n’est pas une option d’esthète ; c’est une condition essentielle de notre liberté et de notre humanité partagée.
Par Patrick MUSHOMBE
[1] Voir par exemple le poème « Il y a » de Guillaume Apollinaire (Calligrammes, 1918), qui énumère les objets et les sensations du front avec une simplicité bouleversante, loin de l’emphase épique.
[2] Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) propose un glossaire exhaustif du DIH. La précision de termes comme « conflit armé non international » est capitale pour l’application du droit. [Lien CICR – Glossaire]
[3] Le chercheur en stratégie Frédéric Ramel analyse ce phénomène dans Le Langage de la guerre (CNRS Éditions, 2022), montrant comment la sémantique participe à la stratégie militaire.
[4] Dans Rêves de droite (La Découverte, 2022), Mona Chollet décortique comment un vocabulaire apparemment anodin ou positif peut servir à véhiculer des idées réactionnaires. Ce mécanisme est transposable à la communication de guerre.
[5] Dans Rêves de droite (La Découverte, 2022), Mona Chollet décortique comment un vocabulaire apparemment anodin ou positif peut servir à véhiculer des idées réactionnaires. Ce mécanisme est transposable à la communication de guerre.
[6] Jonathan Littell, dans Les Bienveillantes (Gallimard, 2006), utilise un mélange de langue administrative, technique et psychologisante pour incarner la conscience d’un bourreau nazi. Olivier Rolin, dans Méroé (Seuil, 2023), interroge la possibilité même de raconter la guerre à travers un récit fragmenté et métaphorique.
[7] Le rapport 2024 de l’Institut de recherche stratégique de l’École Militaire (IRSEM) sur « La Guerre cognitive » détaille comment la manipulation de l’information et du langage est devenue une arme à part entière, visant à saper la cohésion sociale et la volonté politique de l’adversaire.
[8] George Orwell, « Politics and the English Language » (1946). Cet essai fondamental établit un lien direct entre la dégradation de la langue et la défense de régimes politiques oppressifs. Il invite à une vigilance constante contre les clichés, les métaphores usées et les phrases préfabriquées.